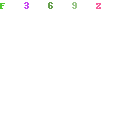Réalisation : Elliot Silverstein
Avec : James Brolin, Kathleen Lloyd, John Marley
Année : 1977 Durée : 1h37 Pays : U.S.A.
"Ô grands frères de la nuit,
Qui avez survolé les vents chauds de l’enfer,
Qui avez demeuré dans l’antre du démon :
Manifestez-vous !"
Qui avez survolé les vents chauds de l’enfer,
Qui avez demeuré dans l’antre du démon :
Manifestez-vous !"
Il fallait bien en exergue une strophe de la bible satanique d’Anton La Vey
pour comprendre à quoi on allait avoir à faire. Tirons grossièrement le trait :
L’enfer mécanique est à l’enfer ce que le Camping-car est au Carlton :
une extension de service plus ou moins représentative de ce que l’on peut
attendre d’un palace. Dans le cas de L’enfer mécanique, on va dire que
c’est plutôt moins, sauf à penser que l’enfer est un endroit particulièrement
surestimé, ce que nous ne pouvons totalement exclure.
Face à la berline diabolique, une paisible bourgade du Nouveau-Mexique comme on en croisait beaucoup dans le cinéma de cette époque. Une communauté joyeuse et saine, limite hippie, qui a tout du cadre de vie idéal fréquenté par la famille Ricorée et leurs cousins Nutella. Tout le monde y est aimable, souriant, bon vivant à l'exception d'un aigri qui bat sa femme et tombe sur ses gosses. Cette longue mise en place narrative est d'ailleurs l'un des point fort de ce film qui accuse aujourd'hui plus de trente ans d'âge.
Second point fort : le bureau du sheriff de Thomas County, avec ses dizaines de policiers pour une bourgade famélique. Habitués à mettre des contraventions et à régler des affaires domestiques, les morts qui s’accumulent soudain font s’écrouler sous leurs yeux terrifiés toutes leurs certitudes. Et c’est comme s’ils se prenaient l’armoire sur la figure : tour à tour ahuris, abattus ou frustrés, ils multiplient les plans foireux, les barrages percés et les duels perdus d’avance dans le plus grand désordre. Trop entraînés à picoler en
 cachette et à bronzer sur le capot de leur véhicule de fonction, notre cheptel
d’agents assermentés est d’une telle nullité qu’il lui faudra in-fine le secours
du seul citoyen bête et méchant de Thomas County pour venir à bout de l’ignoble
Enfer Mécanique, qui de son côté aura méthodiquement pourri l’ambiance de la
congrégation. Imperturbable, elle soulève la poussière sur son chemin, dérange
les répétitions de la fanfare locale, met à terre fanions et trompettes et va
jusqu'à jouer méchamment au chat et à la souris avec les majorettes.
cachette et à bronzer sur le capot de leur véhicule de fonction, notre cheptel
d’agents assermentés est d’une telle nullité qu’il lui faudra in-fine le secours
du seul citoyen bête et méchant de Thomas County pour venir à bout de l’ignoble
Enfer Mécanique, qui de son côté aura méthodiquement pourri l’ambiance de la
congrégation. Imperturbable, elle soulève la poussière sur son chemin, dérange
les répétitions de la fanfare locale, met à terre fanions et trompettes et va
jusqu'à jouer méchamment au chat et à la souris avec les majorettes.S’il a affreusement mal vieilli, The Car n’est jamais ennuyeux, un point qui rend sa revoyure passionnante, en plus du rapprochement évident à faire avec Rubber. Depuis les plans subjectifs collés aux pneus, bitume et pare-chocs, jusqu’à l’équipe de policiers particulièrement inefficaces, en passant par les bruitages qui accompagnent la voiture, tout ce qui fait la trame du non-film de Quentin Dupieux est là, le non-sens inclus. Étonnant.
En bref : The Car est un film étrange et attachant qui se trouve à cheval entre Duel et Christine sans jamais se placer au même niveau. Le temps a rendu ses effets spéciaux désuets, sa mise en scène trop sage ne fait pas le poids face à l’immense réalisation de Spielberg, et son caractère inoffensif fait bien pâle figure devant la cruauté du film de Carpenter. Pourtant sa peinture d’une communauté naïve rend nostalgique, tout comme son absence d’ironie, ses flics dépassés par les évènements, son sens du rythme et son final à la Tex Avery qui font de L’enfer mécanique un titre qui se revoit avec un plaisir aussi coupable que sincère.